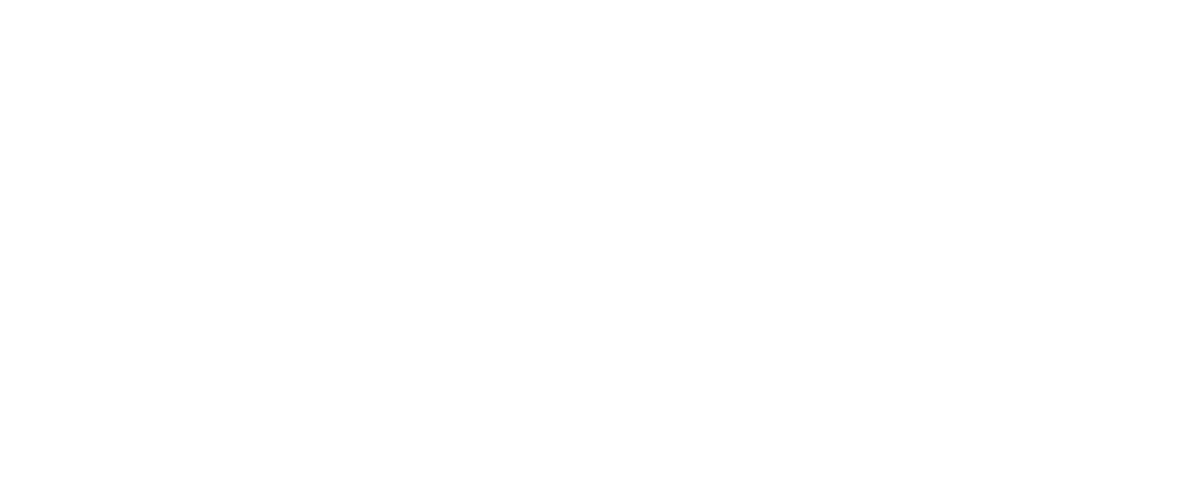Ils ne sont pas Comme Nous
José Eduardo Agualusa (1999)
Judas, il est vrai, fut un traitre, mais… (chercher la traduction)
Cette nuit-là, c’est le Père Antônio Vieira qui sauva Dona Filipinha de Carpo. La vieille dame s’était couchée pour lire le « Sermon des Poissons » et elle était si émerveillée par le discours du Jésuite qu’à deux heures du matin elle était encore réveillée. C’est ainsi qu’elle entendit, venu de la chambre de Carolina, le grincement furtif de la fenêtre qui s’ouvrait suivi, sans aucun doute, par des pas d’homme. Elle se leva en chemise de nuit (une étonnante chemise de nuit en soie imprimée que Charles lui avait rapportée de Singapour) et elle avança dans le couloir, sûre, finalement, que ce qu’elle craignait depuis des années était en train d’arriver. Lorsqu’elle ouvrit la porte, elle vit un homme penché au-dessus de la jeune fille, elle vit que celle-ci dormait, elle vit le couteau, et sut ce qui allait se passer.
– Ne faites pas ça – dit-elle tout bas, – elle n’a que quinze ans.
L’homme se retourna en silence, pointant son couteau sur elle, et murmura:
– Si tu cries, on the tue !
Il avait peur. Dona Filipinha eut pitié de lui :
– Posez votre couteau – lui dit-elle. – Et allons parler.
L’homme avait un air féroce mais en même temps désemparé. Il portait un vieil uniforme de l’armée, très usé, et des sandales qui laissaient voir des ongles de pieds peints chacun d’une couleur différente. Il la regarda d’un air mauvais :
– Parler ? Parler ne chasse pas la faim !
La vieille dame sourit :
– C’est vrai ! Alors allons à la cuisine et je vous sers une soupe chaude. Et après, si vous voulez, nous parlerons.
L’homme la suivit le visage fermé. Dans la cuisine, il s’assit, posa son couteau sur la table, et seulement alors il sembla un peu se calmer.
– À Cuito – dit-il –, on rêvait toutes les nuits de bouffe.
Dona Filipinha le regarda tout en préparant sa soupe :
– Vous étiez à Cuito ?…
L’homme ne sembla pas l’entendre :
– C’était avant qu’on commence à manger les morts. Maintenant on rêve d’eux.
Il prit son couteau et coupa un morceau de pain. Il coupa une grosse tranche de fromage et la mit dans le pain. Il mangea tout sans reprendre son souffle. Dona Filipinha posa devant lui l’assiette de soupe et une cuiller. Il écarta la cuiller, prit l’assiette entre ses mains et avala la soupe :
– Si tu avais été endormie, je t’aurais tranché la gorge –, à toi et à ta fille.
Dona Filipinha remplit à nouveau l’assiette :
– Comment vous appelez-vous ?
L’homme haussa les épaules :
– On n’a pas de nom !
On entendit des tirs à l’extérieur. Une première rafale, tout près, puis une autre plus loin. Une voix fatiguée cria quelque chose. Puis on n’entendit plus rien.
– C’est comme ça toutes les nuits – dit la dame –, la semaine dernière j’ai trouvé un cadavre dans l’escalier. On lui avait coupé les doigts. J’en ai compté huit éparpillés sur le sol. Quelqu’un m’a dit que c’était un bandit.
L’homme regarda bizarrement ses propres mains. Il prit sa cuiller et mangea le reste de sa soupe en silence. Il parla comme s’il était seul.
– Nous étions séminaristes, mais le séminaire a été fermé. Alors nous avons été professeurs dans les cours d’alphabétisation et puis nous avons été enrôlés dans les forces armées. Nous avons fait la guerre pendant vingt ans. Nous avons beaucoup tué et sommes beaucoup mort.
Il se tourna vers Dona Filipinha :
– Il n’en est pas resté beaucoup pour raconter comme ça s’est passé !
Il passa les mains sur son visage et resta de nouveau en silence. S’il avait fermé les yeux on aurait pu penser qu’il s’était endormi. Un lit grinça à l’étage au-dessus. Une femme se mit à gémir tandis que le lit grinçait. C’était comme si elle avait été là, penchée sur la table de la cuisine, tendue et transpirante, mordant les draps et gémissant au même rythme que le lit.
– Trouve-moi un sac – demanda l’homme. – On n’a pas toute la nuit.
Dona Filipinha lui tendit un sac en cuir, vaste et profond, il se leva, ouvrit les tiroirs et commença à en sortir les couverts en argent. A ce moment-là, Carolina entra dans la cuisine, entièrement nue, dans la splendeur éblouissante de ses quinze ans. Elle demeura un instant debout sous la lumière, clignant des yeux, comme une gazelle surprise en plein sommeil :
– J’étais venue chercher un verre de lait– dit-elle. – Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un.
Dona Filipinha la poussa avec tendresse :
– Va dans ta chambre, mon petit. Je t’apporte ton lait.
L’homme secoua la tête :
– Tu ne devrais pas la laisser se promener comme ça. Pas dans les temps qu’on vit, pas dans ce pays.
La dame était inquiète :
– C’est encore une enfant. Elle pourrait être votre fille.
Elle dit cela sans grande conviction. Quand Carolina avait douze ans, elle l’avait enlevée de la maison de sa famille parce que ses cinq frères, tous plus vieux, avaient abusé d’elle (sa mère disait que c’était elle qui avait abusait de ses frères). Elle la voyait grandir maintenant, bellissime, inquiétante, et sentait qu’elle était en train d’élever une fleur carnivore. Elle voulut parler d’autre chose, mais rien ne lui venait à l’esprit.
– J’ai peur d’elle – murmura-t-elle. – Elle n’est pas comme nous.
Pour la première fois l’homme la regarda dans les yeux :
– Ce pays n’est plus le nôtre – dit-il baissant la voix. – C’est leur pays à eux. Dieu nous a abandonnés et le monde nous a oubliés.
Il posa le sac sur la table :
– Tu as des bijoux ?
Dona Filipinha alla dans sa chambre chercher la boîte où elle gardait ses bijoux, l’ouvrit et versa le tout dans le sac. Sa voix tremblait un peu :
– Je n’ai plus rien.
L’homme montra la bague en or qu’elle portait au petit doigt de la main gauche.
– Et ça aussi !
La dame soupira et le regarda en face :
– Ça, ce n’est pas possible. C’est un cadeau de ma grand-mère qui l’a elle-même hérité de sa mère. Elle est dans la famille depuis quatre générations. Je la garde.
L’homme lui saisit la main et lui arracha la bague. Puis, il ramassa le sac, l’accrocha à son l’épaule, sortit de la cuisine, ouvrit la porte d’entrée et s’en alla. Dona Filipinha attendit qu’il descende les escaliers. Elle retourna à la cuisine et remplit un verre de lait. C’est à ce moment qu’elle entendit un vacarme dans la rue, des gens qui couraient, une rafale rapide, des rires. Carolina, nue, était penchée à la fenêtre de sa chambre :
– Mauvaise nouvelle ! – cria-t-elle en se tournant. – Ils ont niqué ton ami !…
Dona Filipinha posa le verre de lait sur la table de nuit et s’assit sur le lit. Elle se sentait très lasse :
– Ce n’était pas mon ami – dit-elle. – Et de toute façon, il était déjà mort.
Trad. : Danielle Schramm